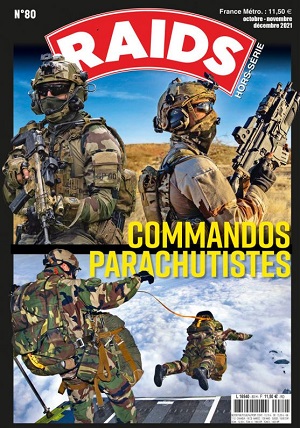Le procès du bombardement de Bouaké se termine par trois condamnations et des questions laissées sans réponse

Le 6 novembre 2004, alors que Laurent Gbagbo, alors président de la Côte d’Ivoire, venait de lancer l’opération « Dignité » afin de reprendre le terrain perdu face à une rébellion apparue deux ans plus tôt, deux avions d’attaque Su-25 « Frogfoot », pilotés par des mercenaires biélorusses et deux officiers ivoiriens, bombardèrent une position alors occupée à Bouaké par des militaires français de la force Licorne, déployée dans le pays pour s’interposer entre les belligérants.
Le bilan fut lourd puisque cette attaque coûta la vie à dix personnes, dont neuf militaires français et un ressortissant américain. En réprésailles, le président Chirac ordonna la destruction de l’aviation ivoirienne.
Et la force Licorne interpella, à Abidjan, 15 techniciens aéronautiques russes, biélorusses et ukrainiens, impliqués dans la mise en oeuvre des deux Su-25 impliqués dans le bombardement de Bouaké. Mais ces derniers furent relâchés et remis au Consul de Russie quelques jours plus tard…. sur un ordre de Paris. « Je n’avais pas du tout envie de relâcher ces personnes. On m’a répondu : tu exécutes! », dira le général Henri Poncet, qui commandait les troupes françaises en Côte d’Ivoire au moment des faits.
Par la suite, huit ressortissants biélorusses, dont un des deux pilotes ayant bombardé la position française à Bouaké, furent arrêtés au Togo. Et si elles demandèrent à Paris ce qu’il fallait en faire, les autorités togolaises ne reçurent aucune réponse. « Devant l’attitude de la France, qui m’a beaucoup étonné, j’ai été amené à prendre des arrêtés d’expulsion », racontera François Boko, alors ministre togolais de l’Intérieur.
Puis, on apprendra plus tard que les deux Su-25 avaient été fournis par un intermédiaire français et que les deux officiers ivoiriens impliqués – le colonel Patrice Oueï et le capitaine Ange Gnanduillet – reçurent une promotion.
D’où les mystères de cette affaire, qui aura mobilisé quatre juges d’instruction au cours de 14 années d’enquête. En janvier 2019, la juge Sabine Kheris ordonna le renvoi devant la cour d’assises de trois des protagonistes du bombardement de Bouaké, à savoir Iouri Souchkine, le colonel Patrice Oueï et le capitaine Ange Gnanduillet, pour « assassinats, tentatives d’assassinats et destructions de biens. » Quand au second pilote biélorusse, Boris Smahine, il bénéficia d’un « non-lieu partiel », faute de « charges suffisantes ».
En outre, la magistrate reprochait également à trois ministres alors en exercice à l’époque, à savoir Michèle Alliot-Marie [défense], Michel Barnier [Affaires étrangères] et Dominique de Villepin [intérieur], d’avoir été « inactifs en étant conscients que cela aboutirait aux remises en liberté des accusés ». Ce qui pouvait relever d’un possible délit « de fourniture de moyens pour soustraire l’auteur d’un crime à une arrestation. »
Finalement, la commission des requêtes de la Cour de Justice de la République [CJR], seule compétente pour juger des ministres, estima que l’inaction reprochée à ces trois personnalités politiques était insuffisante pour constituer « l’infraction de recel, que l’entrave supposait un acte positif, ici non démontré, et que la non-dénonciation impliquait de pouvoir prévenir ou limiter les effets du crime. »
Pour autant, ces trois anciens ministres ont été appelés à témoigner durant le procès qui s’est ouvert le 29 mars dernier… en l’absence des trois accusés, dont un – Ange Gnanduillet est très probablement décédé… depuis 2016.
Lors des débats, les trois anciens ministres se sont renvoyé la patate chaude quand il s’est agi d’évoquer l’arrestation manquée des suspects au Togo. Seule Michèle Alliot-Marie a reconnu avoir été mise au courant de leur interpellation. Et même à deux reprises. « Je sais qu’il y a eu des discussions, et si j’ai bonne mémoire, les services du ministère des Affaires étrangères estimaient qu’il n’y avait pas de possibilité » [de récupéter les suspects, ndlr], a-t-elle témoigné. Et de révéler qu’elle avait demandé s’il était possible « de monter une opération de la DGSE » mais « on m’a dit ‘ça ne sert à rien, ils sont déjà repartis' ».
Alors chef de la diplomatie française à l’époque, Michel Barnier, a dit « n’avoir aucun souvenir d’avoir donné quelconque instruction pour libérer » les mercenaires biélorusses arrêtés. Ce que contredit le témoignage de Gildas Le Lidec, ambassadeur de France en Côte d’Ivoire au moment des faits. En tout cas, l’ex-chef du Quai d’Orsay a renvoyé la responsabilité de cette affaire sur l’Élysée. Selon lui, le président Chirac qui aurait assuré « de manière très claire, catégorique » que le dossier ivoirien était une « question qui concernaient les militaires. « J’ai compris à ce moment-là que [toute question liée à ce pays] se réglerait au niveau du chef de l’État et des autorités militaires », a-t-il conclu.
De son côté, Dominique de Villepin a également pointé la responsabilité de l’Élysée, mais aussi celle du Quai d’Orsay et du ministère de la Défense. Et il a assuré n’avoir été « ni présent, ni associé, ni informé » des décisions prises sur la Côte d’Ivoire. Ce qu’a contesté Michel de Bonnecors, alors chef de la cellule « Afrique » à la présidence de la République. Selon lui, l’affaire « togolaise » a été traitée par le ministère de l’Intérieur. Et d’assurer qu’il n’avait pas été mis au courant de l’arrestation des mercenaires biélorusses [qu’il apprendra dans la presse, un an plus tard…].
Même chose pour le général Jean-Louis Georgelin, alors chef d’état-major particulier du président de la République. « Je n’ai jamais été saisi de cela et n’en ai pas parlé au président » [Chirac], a-t-il témoigné. Et, s’agissant du volet togolais de l’affaire, il « concernait les ministères des Affaires étrangères, de la Défense et les Affaires juridiques », a-t-il dit.
Finalement, au bout de 14 ans d’enquête et trois semaines de procès, le bombardement de Bouaké garde ses mystères. Seuls les trois « exécutants », dont un sans doute déjà décédé, ont été condamnés, ce 15 avril, à la perpétuité, conformément aux réquisitions de l’avocat général, Jean-Christophe Müller. « Cette peine, je l’aurais requise dans les mêmes conditions si ces personnes étaient ici, si elles s’étaient défendues, parce que ce qui justifie cette peine, c’est la violence inouïe des faits », avait-il justifié.