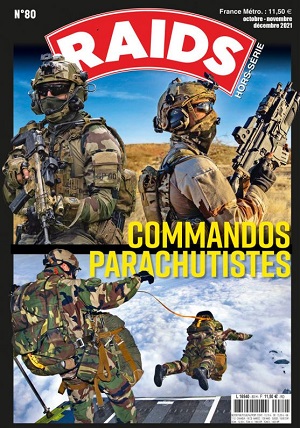La grande explication attendra : l’Otan pousse les alliés européens à s’entendre avec la Turquie

Après des semaines d’escalade militaire dans la province syrienne d’Idleb, où Ankara a lancé l’opération « Bouclier de printemps » en réponse à des frappes attribuées aux forces de Damas contre ses troupes [lesquelles ont eu une trentaine de tués dans leurs rangs], le président turc, Recep Tayyip Erdogan, et son homologue russe, Vladimir Poutine, se sont mis d’accord sur un cessez-le-feu lors d’une rencontre à Moscou, le 5 mars.
Pour rappel, la province d’Idleb, alors contrôlée par les jihadistes, notamment ceux du Hayat Tahrir al-Sham [HTS], avait été déclarée « zone de désescalade » dans le cadre du processus d’Astana et de l’accord russo-turc de Sotchi, la Turquie voulait y éviter une offensive à la fois pour ne pas provoquer un nouvel afflux de réfugiés vers son territoire et protéger les groupes rebelles syriens qu’elle soutient. Seulement, considérant qu’Ankara n’avait pas tenu ses engagements à l’égard des formations terroristes, Moscou a appuyé l’offensive des forces syriennes. D’où l’escalade militaire de ces derniers jours.
Entré en vigueur le 6 mars à minuit, cet accord prévoit la mise en place d’un « couloir de sécurité » de 6 kilomètres de profondeur de part et d’autres de la stratégique autoroute M4, dont le contrôle a motivé les combats de ces derniers jours. En clair, il s’agit donc d’instaurer une sorte de zone tampon de 12 kilomètres de large, ce qui met les localités de Jisr al-Choghour et d’Ariha, qui échappent au régime syrien, à l’abri d’une éventuelle offensive. Les « paramètres de cette zone » devront été définis sous 7 jours. En outre, des patrouilles russo-turques le long de cet axe crucial seront organisées à partir du 15 mars.
Ces récents affrontements entre les forces syriennes et turques ont mis à mal la relation entre Ankara et Moscou, qui, malgré des intérêts divergents, tant en Syrie qu’en Libye, ont accru leur coopération au cours de ces dernières années. Y compris au niveau militaire, la Turquie ayant acquis des systèmes de défense aérienne russes S-400 malgré les avertissements des États-Unis [qui l’ont éjectée du programme F-35] et de l’Otan.
Après la signature de l’accord de cessez-le-feu pour Idleb, M. Erdogan a d’ailleurs souligné que le fait que la Turquie et la Russie entretiennent des « relations profondément enracinées » et que son « plus grand désir » serait de les « renforcer davantage ».
Or, durant cette séquence marquée par de fortes tensions militaires, la Turquie n’a pas manqué de solliciter l’Otan, via l’article 4 du Traité de l’Atlantique-Nord, qui indique que « tout allié peut demander des consultations chaque fois que, de l’avis de l’un d’entre eux, son intégrité territoriale, son indépendance politique ou sa sécurité sont menacées. » En outre, Ankara a demandé, à plusieurs reprises, aux États-Unis de lui fournir des systèmes de défense aérienne Patriot.
Dans le même temps, et afin de la contraindre à soutenir sa politique en Syrie, le président turc a engagé un bras de fer avec l’Union européenne en décidant d’ouvrir la frontière turques aux migrants voulant se rendre en Europe. Ce qui met notamment la Grèce sous tension. Le 5 mars, le ministre turc de l’Intérieur, Süleyman Soylu, a annoncé le déploiement de 1.000 membres des forces spéciales de la police turque le long du fleuve Evros [Meriç en turc] afin d’empêcher les policiers et garde-frontières grecs de « repousser » les migrants.
Ce 6 mars, de nouveaux heurts ont éclaté à la frontière entre la Grèce et la Turquie, des gaz lacrymogènes ayant été tirés du côté turc vers les garde-frontières grecs. À Athènes, où l’on voit dans ces tensions frontalières une menace à la sécurité nationale, un responsable a accusé la police turque de vouloir aider les migrants à pénétrer en Grèce via des opérations « coordonnées au moyen de drones ».
Cette forme de chantage exercé par M. Erdogan à l’endroit de l’UE n’est pas le seul sujet de contentieux. Les activités de prospection gazière dans les eaux de la République de Chypre en est un. L’offensive lancée en octobre par la Turquie contre les milices kurdes syriennes [YPG], engagées dans la lutte contre l’État islamique [EI ou Daesh] en est un autre. Cela étant, dans cette affaire, la France est sans doute le pays européen le plus critique à l’égard d’Ankara. D’où les récents propos tenus par Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, lors d’un intervention au Sénat.
« Nous sommes dans la même alliance [l’Otan, ndlr]. Je pense qu’il nous faudra avoir rapidement avec la Turquie une grande explication, lourde, franche, publique pour savoir de quel côté est l’un, de quel côté est l’autre et là où sont nos intérêts communs et dire tout cela, fortement sinon on ne s’en sortira pas », a en effet estimé le chef de la diplomatie française.
Justement, cette explication « franche » pourrait bien attendre. Représentant spécial des États-Unis pour la Syrie, James Jeffrey ainsi appelé les Européens à soutenir davantage la Turquie.
« Il y a diverses démarches diplomatiques que nous avons entreprises ou pourrions entreprendre, y compris mobiliser les Européens », pour venir en aide à la Turquie, a-t-il affirmé, le 5 mars, depuis Istanbul. « L’un des principes partagés par le président [Trump] et le Congrès américain est celui de la nécessité d’un effort collectif, non seulement de la part de la Turquie et des Etats-Unis, mais aussi nos alliés de l’Otan, essentiellement les Européens », a-t-il ajouté. « Nous sommes en train de pousser les Européens a contribuer d’une manière significative. Je cite comme exemple la batterie de Patriot espagnole déployée en ce moment en Turquie sur la base d’Incirlik. Nous voulons voir d’autres actions similaires de la part de l’Otan », a-t-il poursuivi.
Le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, n’est pas loin de partager de telles vues. « Il y a des différences et des désaccords sur la manière de gérer la situation en Syrie. Mais la Turquie est un allié important et elle a joué un rôle important dans la lutte contre l’État islamique », a-t-il plaidé, dans un entretien donné à l’AFP.
Cependant, les opérations lancées par Ankara contre les milices kurdes syriennes, n’ont pas aidé la coalition anti-jihadiste. Celle, par exemple, menée dans le canton d’Afrine, en janvier 2018, a retardé la chute du califat auto-proclamé par l’organisation jihadiste. Par ailleurs, la zone où s’était retranché Abou Bakr al-Baghdadi, le chef de cette dernière, avant d’être éliminée par les forces spéciales américaines, pose question.
« La Turquie doit nous fournir des explications », avait ainsi réagi Brett McGurk, ex-envoyé de la Maison Blanche pour la coalition, dans une tribune publiée par le Washington Post. « Baghdadi n’a pas été retrouvé dans ces régions traditionnelles dans l’est de la Syrie ou dans l’ouest de l’Irak – mais simplement à quelques kilomètres de la frontière turque, et dans la province d’Idleb, qui a été protégée par une dizaine d’avant-postes militaires depuis le début de l’année 2018 », avait-il souligné.
Président de la commission des affaires étrangères du Parlement allemand et prétendant à la succession de la chancelière Angela Merkel, Norbert Roettgen a défendu la nécessité de coopérer avec la Turquie, au nom de la « realpolitik ».
« Nous devons faire face à la réalité et si vous voulez aider les réfugiés, vous devez coopérer avec la Turquie », a déclaré M. Roettgen à l’Institut Montaigne, à Paris, selon l’AFP. « Je ne vois pas de stratégie sans la Turquie. La réalité, cela ne vous ravira peut-être pas, est que la Turquie est l’État frontalier entre l’Europe et le Moyen-Orient », a-t-il insisté.